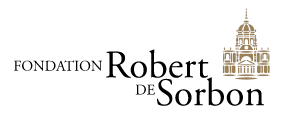« L’ENJEU POUR NOUS EST D’ARRIVER À FAIRE COMPRENDRE L’UTILITÉ DE LA DONNÉE 3D »
UNE CONVERSATION AVEC BASTIEN VAROUTSIKOS
- Auteur : Hanna Balme
- Image : @Iconem - Bamiyan - Afghanistan
- Date : 25 janvier 2023

Bastien Varoutsikos est archéologue et spécialiste du patrimoine culturel en zones de conflit. Diplômé de Harvard, il est aujourd’hui directeur commercial à Iconem, startup française spécialisée dans la numérisation 3D des sites patrimoniaux.
Cet entretien, réalisé en octobre 2022 par Iconem et la Fondation Robert de Sorbon à l’occasion du lancement de l’Observatoire pour le patrimoine culturel en danger d’Iconem, offre un état des lieux détaillé sur la préservation du patrimoine aujourd’hui, en France et dans le monde. Revenant brièvement sur son parcours, Bastien Varoutsikos insiste sur la persistance de ses liens avec le milieu académique, et sur l’importance de continuer à transmettre le savoir. Il nous expose ensuite le travail réalisé par Iconem pour la préservation du patrimoine en danger, notamment pour le patrimoine afghan, et réaffirme la mission scientifique et académique d’Iconem à travers la création de cet Observatoire. Il conclut enfin avec une analyse des relations qu’entretiennent les différents acteurs du patrimoine (institutions de recherche, acteurs privés, organismes internationaux et étatiques, musées, etc.), soulignant ainsi le rôle de l’expertise académique en temps de crise.
UN PARCOURS ENTRE MONDE ACADEMIQUE ET SECTEUR PRIVE, MARQUE PAR LA VOLONTE DE TRANSMETTRE
Pouvez-vous tout d’abord nous parler de votre sujet de thèse sur la diffusion des savoirs agricoles au Néolithique au Moyen-Orient ? Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce sujet, sur cette région, sur cette période, en particulier ?
Bastien Varoutsikos – À l’époque, je faisais ma thèse dans un département d’anthropologie à Harvard. Aux États-Unis, ces départements sont généralement divisés en quatre sous-domaines où se côtoient l’anthropologie sociale, la linguistique et l’archéologie. Le but de cette thèse était donc d’analyser des données archéologiques du point de vue des dynamiques sociales et humaines, de manière à ce que les questions et les solutions proposées par ce travail puissent être toujours pertinentes aujourd’hui.
Ce qui m’intéressait surtout dans le néolithique, c’était la manière dont le savoir est transféré entre les groupes. De ce point de vue, le néolithique dans le Caucase est particulièrement intéressant : si l’on part du principe que le Néolithique se développe petit à petit, dans une zone qui va de la Turquie du sud-est au sud du levant, on se rend compte que cela a pris quasiment autant de temps à aller de cette zone-là au Caucase, qui n’est qu’à quelques centaines de kilomètres, qu’à se diffuser en Europe. La question était donc de savoir pourquoi ? Qu’est-ce qui a pris autant de temps, et pourquoi est-ce que cela a pris autant de temps ? Comment est-ce que le savoir a aussi évolué au cours de cette diffusion ? Ce qui m’intéresse fondamentalement, c’est comment le savoir entre les groupes est accepté ou au contraire refusé, quels sont les mécanismes qui sous-tendent le partage de savoirs entre les groupes.

Je ne crois pas que cela puisse être évité, car il y a tellement de contraintes dans le montage et le financement d’un projet au niveau national.
J’ai donc essayé de développer des approches statistiques qui, à travers l’étude de la culture matérielle préhistorique, nous permettaient d’identifier différents types de contacts entre groupes sociaux. J’ai par exemple utilisé des analyses biochimiques de la fluorescence à rayon X sur l’obsidienne afin d’identifier la manière dont celle-ci se diffuse. L’obsidienne, qui est une matière première précieuse, ne se trouve que dans quelques endroits très circonscrits au Moyen-Orient, principalement dans le centre de l’Anatolie. Or, on en retrouve aujourd’hui jusqu’en Iran ou en Égypte par exemple. Des trajectoires comme celles-ci montrent qu’il y a eu un contact entre les groupes à un moment donné, et mon but était de déterminer quels étaient ces contacts. Cela m’a amené à passer un certain temps avec des groupes nomades entre l’Iran, l’Iraq, l’Arménie et la Turquie, dans une approche un peu plus ethnographique, pour apprendre comment ces groupes nomades sont amenés à interagir entre eux – et en extrapolant ensuite des modèles statistiques. Et j’ai ensuite ancré toutes ces recherches dans un site archéologique situé à la frontière entre l’Arménie et la Géorgie que j’avais trouvé dans le cadre de la mission Caucase, financée par le Ministère des Affaires étrangères français à l’époque.
Pour résumer, ma thèse suggérait que des groupes se trouvant dans le nord de la Mésopotamie à la fin du 7e millénaire ont été forcés de partir et de monter sur les plateaux d’Iran, du côté de la mer Caspienne, à cause d’une crise climatique. Ils ont ensuite remonté petit à petit les deux cours de la Koura et de l’Araxe, et se sont installés ici. Il y a même eu des phases d’interaction entre les agriculteurs, qui étaient dans le fond des vallées, et les chasseurs-cueilleurs des plateaux, qui eux étaient “locaux”.
Aujourd’hui, vous travaillez donc pour Iconem, une startup spécialisée en numérisation 3D des sites patrimoniaux. Comment s’est fait la transition du monde de la recherche à celui du privé ? Est-ce que vous vous considérez toujours comme appartenant au milieu académique ?
Après ma thèse, je devais continuer en post-doctorat à Paris dans le cadre d’un projet ANR [financé par l’Agence Nationale de la Recherche], mais cela faisait déjà quelques années que j’avais commencé une transition vers des projets un peu plus appliqués sur le patrimoine culturel, notamment à cause de la guerre en Syrie, un pays que j’aimais beaucoup et dans lequel j’avais beaucoup voyagé. J’avais envie de sortir du théorique pur pour m’investir dans des projets plus pratiques, avec ce qui me paraissait comme ayant un impact un peu plus direct sur les sociétés dans lesquelles on a envie de vivre. J’ai donc commencé en éditant des rapports hebdomadaires pour une petite ONG, afin de petit à petit construire un portfolio d’expériences. J’ai ensuite rejoint l’ONG Turquoise Mountain en Afghanistan, où je me suis lancé dans la documentation du patrimoine immatériel, et notamment dans la mise en place d’un cadre pour pouvoir documenter les savoir-faire artisanaux locaux. J’ai réalisé que ce qui m’intéressait dans l’archéologie, c’était surtout de pouvoir analyser les mécanismes sous-jacents de la culture : comment elle se transforme, comment est-ce qu’on arrive à préserver non pas des items culturels, mais ces mécanismes de transformation. C’est précisément ce qui est intéressant, car si nous ne préservons pas ces mécanismes, nous nous contentons de geler une donnée culturelle dans un état temporellement restreint – ce qui ensuite devient la mort d’une société. L’enjeu principal est donc de savoir comment est-ce qu’on arrive à préserver les mécanismes de réinvention et de transmission.
Vous avez donc quitté ce milieu du patrimoine immatériel pour revenir à du patrimoine bâti, à l’archéologie ?
C’est vraiment Iconem qui m’a fait revenir à au patrimoine matériel petit à petit. J’ai rencontré Yves [Ubelmann, fondateur d’Iconem] à Paris en 2016, lors de l’exposition Sites Éternels au Grand Palais. Nous sommes restés en contact lorsque l’ONG Turquoise Mountain a eu besoin de faire un relevé 3D, et nous avons vu que l’on s’entendait bien. Et il y a des moments où on a l’impression que vie professionnelle et vie personnelle s’alignent. C’était le cas pour moi à l’époque, car j’avais aussi envie de rentrer à Paris.
Dès mon arrivée à Iconem, j’ai essayé d’intégrer des questions de patrimoine immatériel. Lors de nos déplacements pour faire des scans 3D, nous réalisons de plus en plus des entretiens avec les gens sur place. Par exemple, lors d’un projet au Mali, à Tombouctou, Yves et moi allions de maison en maison, de mosquée en mosquée pour interroger les habitants sur les mythes fondateurs de la ville, sur les techniques de banco [c’est-à-dire de construction, de conservation et de maintenance des monuments], sur la structure des mosquées. Notre objectif était de mettre un peu de matière sur les modèles 3D et d’avoir un ancrage un peu plus pertinent dans la communauté.
En parallèle, je pense que je reste profondément académique dans mon approche intellectuelle, même si mon travail diffère. Je reste intéressé par la recherche, par l’écriture : je continue à soumettre et à publier des articles, que ce soit sur le patrimoine immatériel ou sur le travail que nous accomplissons à Iconem. Je publie partout où je peux, sur The Conversation, par exemple, mais aussi dans des journaux un peu plus grand public ou au contraire, des revues scientifiques. Jusqu’à l’année dernière, j’étais encore ATER [attaché temporaire d’enseignement et de recherche] à Paris I. Il est important que le savoir ressorte et se partage. Malheureusement, je manque de temps pour publier autant que je voudrais, mais c’est aussi un des buts de l’Observatoire pour le patrimoine en danger que nous sommes en train de créer : arriver à recycler, à réutiliser tout ce que l’on a pu apprendre dans le monde académique, et à le rendre plus disponible. Donc j’essaie de garder un équilibre entre le monde académique et le monde privé – qui sont vraiment différents.
UN OBSERVATOIRE POUR LE PATRIMOINE EN DANGER QUI REAFFIRME LA VOCATION SCIENTIFIQUE D’ICONEM
Justement, vous êtes en train de créer un observatoire du patrimoine en danger dans le but d’affirmer l’identité académique et scientifique d’Iconem. Pour cela, vous avez établi une liste de trois sites “témoins”. Quels sont ces sites, et comment les avez-vous choisis ?
Il faut savoir qu’Iconem est une petite entreprise, qui peine à trouver son modèle économique. On a, au sein d’Iconem, des gens qui sont vraiment excellents en R&D, d’excellents artistes 3D aussi, que nous arrivons à garder parce qu’il y a un sens de la cause. C’est quelque chose que nous avons besoin de préserver, et c’est aussi pour cela que l’on a créé cet observatoire. Pour nous, c’est aussi une question de survie car si Iconem se transforme uniquement en société de production d’expositions, nous risquons de perdre cette ressource humaine essentielle, qui est principalement intéressée par ce sens de la mission. Avec cet observatoire, nous voulons donc clarifier la position d’Iconem vis-à-vis du monde scientifique et des musées, qui sont à la recherche d’expertise plutôt que d’expositions.
L’objectif, avec ces sites témoins, est donc surtout de créer une preuve de concept. Ce sont des sites sur lesquels nous avons déjà des données historiques, ainsi que des scans 3D réalisés il y a quelques années. Ces sites vont ensuite nous permettre de tester différents types de méthodes. La liste finale de ces sites est encore en train d’être stabilisée, mais y figurent déjà Bâmiyân en Afghanistan, et Venise. Pour Bâmiyân par exemple, nous souhaitons tester l’évolution de l’érosion, et nous venons tout juste de commencer les analyses du site. À terme, notre objectif est de venir tester différentes méthodes d’observation et de supervision : quels sont les différents types d’analyses que l’on peut faire sur le modèle 3D, qui vont ensuite nous permettre d’identifier des changements dans le site patrimonial pour venir informer les méthodes et les stratégies de préservation.
Concernant Venise, vous avez réalisé pendant le confinement des relevés 3D de la ville, qui sont aujourd’hui exposés au Grand Palais immersif. Comment vous est venu ce projet ?
Nous avons saisi une opportunité qui s’est présenté pendant le COVID. Il y avait d’une part les financements du gouvernement, et notamment les prêts à 0 %, qui nous ont permis d’investir. On ne voulait pas emprunter juste pour emprunter, mais plutôt investir cet argent dans des projets phares pour l’entreprise. D’autre part, le confinement nous a aussi beaucoup facilité la tâche lors de la réalisation des scans 3D. Grâce à ces financements, nous avons donc pu aller faire des scans de certains sites, profitant du fait qu’il n’y avait personne. Nous avons ainsi des scans du Sacré-Cœur de Paris, par exemple, et effectivement des scans de Venise.
En réalité, nous avions déjà prévu de faire des scans de Venise, ou en tout cas de certaines parties de la ville, en collaboration avec Frédéric Kaplan, de Venice Time Machine, et la Factum Foundation, afin de comparer nos méthodes. Nous avons ensuite eu un bon contact avec la Fondazione Musei Civici di Venezia [organisme en charge de la gestion des sites patrimoniaux à Venise]. Cela s’est donc fait de manière à la fois très organique, mais avec beaucoup d’efforts aussi pour obtenir les autorisations d’utilisation de drones dans la ville.
Mais ce projet n’est-il pas potentiellement contre-intuitif par rapport à ce que vous faites, par rapport aux missions et aux objectifs de l’Observatoire de s’inscrire dans une démarche plus scientifique, plus académique ? Comment est-ce que ce projet s’insère dans votre désengagement progressif d’une dépendance trop forte de l’économie des expositions, qui a aussi un impact sur votre légitimité et sur la manière dont vous êtes perçus, notamment par les institutions muséales ?
Je pense que c’était une approche totalement décomplexée. Cela faisait déjà quelque temps que l’on commençait à se dire qu’il nous fallait faire de la captation de sites pour créer un portfolio qui allait être utilisé à des fins d’expositions. Et cette opportunité de faire des scans 3D de Venise s’est créée petit à petit, à travers le programme avec Frédéric Kaplan et Factum, par la relation qu’on avait avec Musei Civici et leurs besoins. Nous savions dès le départ que nous aurions le soutien de l’institution en charge de gérer le site.
De plus, il se trouve qu’un an auparavant, j’avais écrit une note de concept sur le besoin pour Iconem de travailler sur les questions de patrimoine culturel et le changement climatique. Nous avions donc commencé à mettre en place une liste de sites intéressants de ce point de vue-là, dont Venise faisait partie. Et il nous faut admettre qu’on a aussi besoin de beaux sites, qu’on a besoin de faire des expositions pour faire rentrer de l’argent et assurer la stabilité et la longévité d’Iconem.
Il émerge aujourd’hui une conscience décoloniale très forte, avec notamment un impact sur les questions de patrimoine et une visibilité accrue des questions de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, ainsi que la question de restitutions ou de prêts de long terme dans le cadre des revendications de biens culturels. Dans ce contexte-là, on voit apparaître de nouveaux acteurs, qui, revendiquant la neutralité de leur approche technologique, viendraient peut-être créer une nouvelle dépendance à l’échelle globale. Il se pose alors des questions de propriété de la donnée, de réappropriation éventuelle de pratiques scientifiques, etc. Est-ce que l’on assiste à un nouveau colonialisme dans les rapports Nord-Sud, dont vous seriez parmi les acteurs ?
C’est une question intéressante, celle des privilèges, des colonialismes, du postmodernisme aussi. Ce sont des sujets omniprésents à travers tous les domaines aux États-Unis, tandis qu’en France ils semblent un peu plus confinés à un certain domaine. Comment est-ce que l’on crée ? Comment est-ce que l’on utilise ces outils théoriques, dont parlent Latour, Derrida et Foucault, pour avoir une discussion sur des questions très techniques ? Ce sont des discussions que j’ai beaucoup eues avec Yves, car il faut reconnaître que nous sommes deux hommes, blancs, qui arrivent au Mali, par exemple, avec des outils parfois développés en interne ; avec des caméras et des drones qui ne sont pas forcément disponibles localement, ou dont les pièces de rechange peuvent uniquement se trouver à l’international ; avec des besoins de supers ordinateurs pour traiter les modèles 3D que nous réalisons ; des besoins de stockage accessible uniquement avec de la bande passante très importante ; et surtout, avec notre approche de ce qui nous intéresse sur le modèle, qui varie selon la nature du programme : est-ce que nous sommes à la recherche d’éléments pour une création d’exposition, est-ce que nous sommes à la recherche d’informations pour la restauration et la gestion d’un site… ?
La question du colonialisme numérique est surtout celle de l’utilisation de la 3D pour justifier un statu quo actuel en termes de rapatriement des objets par exemple, ou de protection des sites. Parfois, il s’agit même de renforcer ces différences Nord-Sud dans l’accès et la gestion des données par l’acquisition et l’utilisation de la 3D. À Iconem, nous essayons de réfléchir à ces questions, et de les transformer dans notre pratique. D’un point de vue purement technique, cela nous amène à faciliter l’acquisition de la donnée. C’est pour cela que nous préférons la photogrammétrie à la lasergrammétrie, par exemple. Il est beaucoup plus facile de donner un appareil photo, même bas de gamme, à n’importe qui, que de faire une captation laser, beaucoup plus complexe. Nous avons fait le choix de la photogrammétrie justement parce que cela se transmet plus facilement. Systématiquement, nous prévoyons de former des gens sur place lors de nos missions – l’avantage pour nous est que ces gens sont ensuite capables de réaliser des captations supplémentaires pour nous si besoin. Et beaucoup d’entre eux finissent par créer leur propre entreprise et deviennent des prestataires d’Iconem.

La question du colonialisme numérique est surtout celle de l’utilisation de la 3D pour justifier un statu quo actuel en termes de rapatriement des objets par exemple, ou de protection des sites.
Voilà pour la captation et l’acquisition de la donnée. Maintenant qu’en est-il du traitement de la production 3D ? Cette question est un peu plus compliquée car elle nécessite un minimum de technique, des logiciels qui sont de plus en plus chers. Nous essayons de trouver des solutions en ayant des sponsors, mais aussi en essayant de trouver des logiciels équivalents en open source. Nous intégrons de plus en plus dans nos budgets l’achat d’ordinateurs qui ont la capacité de traiter des données comme celles que nous captons, et de créer des modèles 3D. Nous avons complètement équipé, par exemple, le département des antiquités de Beyrouth avec des drones, des appareils photo, des ordinateurs. Nous avons formé une équipe, qui est désormais capable de faire ses propres captations. C’est aussi ce que nous avons fait au Cambodge, sur le site d’Angkor Vat, avec l’Apsara [Autorité pour la Protection du Site et l’Aménagement de la Région d’Angkor] : nous avons amené des ordinateurs, trouvé des licences pas chères, etc. Tout cela implique un cadre administratif et budgétaire compliqué car aucun programme de patrimoine culturel n’est prêt à financer de la formation sur cinq ans, mais nous arrivons à structurer nos budgets de manière à justifier des paiements de salaires sur la longue durée.♦
Cet entretien a été réalisé par la Fondation Robert de Sorbon en collaboration avec Iconem.